Jean-Baptiste Lecuit
Les quatorze ouvrages recensés sont tirés d’une présélection de soixante-dix, pour la plupart publiés en anglais ou en allemand. C’est dire la vitalité de la recherche en anthropologie théologique, ainsi que la faiblesse quantitative de la production de langues latines, en particulier française. La sélection finale a valorisé autant que possible cette dernière, tout en privilégiant plus généralement la créativité et la complémentarité des approches (notons que livre d’Emmanuel Durand, Théologie de l’espérance, Éd. du Cerf, 2024 a déjà été recensé par David Sendrez dans son bulletin de théologie fondamentale, RSR 113/3 [2025], p. 570-572 et a pour cette seule raison été écarté de la sélection effectuée).
I. Ouvrages généraux (1-4)
II. Anthropologie théologique fondamentale (5-6)
III. Grâce (7-8)
IV. Péché originel (9)
V. Eschatologie (10-14)
I. Ouvrages généraux
1. RAHNER Karl, Impulsions pour la théologie systématique. Contributions à la théologie fondamentale et à la dogmatique, « Œuvres » 30, Éd. du Cerf, Paris, 2023, 876 p.
2. RATZINGER Joseph, Herkunft und Bestimmung. Schöpfungslehre, Anthropologie, Mariologie, « Gesammelte Schriften » 5, Herder, Freiburg im Br., 2021, 627 p.
3. WERBICK Jürgen, Christlich glauben. Eine theologische Ortsbestimmung, Herder, Freiburg im Br., 2019, 431 p.
4. WERBICK Jürgen, Theologie anthropologisch gedacht, Herder, Freiburg im Br., 2022, 452 p. (Una teologia in prospettiva antropologica, BTC 226, Queriniana, Brescia, 2025, 448 p.).
II. Anthropologie théologique fondamentale
5. TETZLAFF Karl, Selbstsein und Anerkennung. Theologisch-philosophische Erkun-dungsgänge im Spannungsfeld von Ich, Wir und Gott, « Dogmatik in der Moderne » 39, Mohr Siebeck, Tübingen, 2022, 433 p.
6. ETZELMÜLLER Gregor, Gottes verkörpertes Ebenbild. Eine theologische Anthropolo-gie, Mohr Siebeck, Tübingen, 2021, 402 p.
III. Grâce
7. LIAUTAUD Jean-Marc, En toute gratuité ? Penser la grâce sous le paradigme de l’alliance, CF 320, Éd. du Cerf, Paris, 2023, 700 p.
8. HART David Bentley, You are Gods. On Nature and Supernature, University of Notre Dame Press, Notre Dame (Indiana), 2022, 139 p.
IV. Péché originel
9. SPENCER Daniel H., Forsaking the Fall. Original Sin and the Possibility of a nonlap-sarian Christianity, « Routledge studies in analytic and systematic theology », Routledge, Oxon – New York, 2023, 203 p.
Ce thème est également traité dans les ouvrages de Rahner (notice 1) et Etzelmüller (notice 6).
V. Eschatologie
10. MÜHLING Markus, Grundinformation Eschatologie. Systematische Theologie aus der Perspektive der Hoffnung, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2022 (2. Aufla-ge), 464 p.
11. BOERSMA Hans, Seeing God. The beatific Vision in Christian Tradition, Eerdmans, Grand Rapids (Michigan), 2018, 467 p.
12. SATTLER Dorothea, GRUND-WITTENBERG Alexandra (éds.), Hölle, « Jahrbuch für Biblische Theologie » 36, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2023, 381 p.
13. BROTHERTON Joshua R., “Grace Abounds More”. Balthasars Eschatological Uni-versalism in Dialogue, « Brill’s Studies in Catholic Theology » 13, Brill, Leiden, 2023, 280 p.
14. HRONICH Andrew, Once Loved Always Loved. The Logic of Apokatastasis, Wipf & Stock, Eugene (Oregon), 2023, 400 p.
***
Douze ans après le premier bulletin d’anthropologie théologique, où la Theologische Anthropologie de Thomas Pröpper était longuement recensée (RSR 101/2 [2013], p. 252-260), l’importance de cette œuvre monumentale se fait encore sentir dans la prise de distance tout à fait justifiée de Jürgen Werbick au sujet de la nature de la liberté, déjà repérée dans le précédent bulletin : contrairement à ce que défendent Pröpper et ses disciples (tels Magnus Striet ou Saskia Wendel), la liberté ne consiste pas essentiellement dans la possibilité de choix alternatifs, effectués en radicale indépendance, mais dans la possibilité, donnée par Dieu agissant intérieurement par grâce, de vivre et d’agir en conformité avec le vouloir de ce qui est véritablement préférable. En sa plénitude, elle implique la perte de la possibilité existentielle de se détourner de Dieu, en une participation complète à la liberté filiale de Jésus, sans péché car souverainement libre.
Du présent bulletin, trois figures émergent, respectivement catholique, orthodoxe et protestante : celle de Jürgen Werbick (notices 3 et 4), dont les ouvrages recensés constituent une contribution marquante à l’anthropologie théologique ; celle de David Bentley Hart (notice 8), dont il a fallu renoncer à recenser le brillantissime ouvrage purement philosophique All Things Are Full of Gods. The Mysteries of Mind and Life (YUP, 2024), dans lequel il réfute les arguments en faveur de la réduction de la vie et de l’esprit à la matière ; et celle de Markus Mühling (notice 10), dont on attend avec intérêt le troisième tome de la Post-systematische Theologie, la recension du deuxième étant reportée au prochain bulletin.
Au plan thématique, les contributions les plus originales concernent le péché originel, dont l’universalité est à penser dans son rapport avec le caractère naturel des tendances égoïstes et violentes héritées de l’évolution biologique (Etzelmüller et Spencer, notices 6 et 9) ; la sexualité, catastrophiquement dépréciée dans le christianisme historique, et encore trop peu considérée à la lumière de la biologie et des sciences humaines (Werbick, notice 4) ; la gratuité, à penser selon le paradigme de l’alliance, en opposition à la déliaison et à l’utilitarisme contemporains, mais aussi à l’obligation de croire, au conditionnement de la charité, ou à un faux désintéressement, secrètement animé par le désir de maîtrise (Liautaud, notice 7) ; la divinisation, but de la création, conformation au Christ et participation à Dieu (Hart, Mühling et Boersma, notices 8, 10 et 11) et même, pour Mühling, à sa « corporéité » non matérielle ; la vision de Dieu, plénitude de la divinisation, donnée de manière inchoative dans la foi, ayant possiblement une dimension corporelle (notice 11). Le débat au sujet de l’universalité du salut, dont le précédent bulletin avait commencé à rendre compte, est toujours en cours, que cette universalité soit pensée comme objet d’espérance, pour Tappen, Ansorge et Brotherton (notices 12 et 13), ou de certitude, pour Hart et Hronich (notices 10 et 14). En raison du conflit entre le rejet magistériel de l’apocatastase et la puissance des arguments universalistes, ce débat aux implications missionnaires et pastorales potentiellement lourdes sera à suivre avec attention. Il conviendra de le faire en tenant compte de l’exégèse et de l’interprétation théologique des versets universalistes et de ceux classiquement considérés comme évoquant la damnation éternelle, des études patristiques au sujet de la présence de l’universalisme dans les premiers siècles chrétiens, du statut et de la portée exacte des condamnations de l’apocatastase, et des enjeux du pardon des bourreaux par leurs victimes, essentiel à la réconciliation eschatologique espérée.
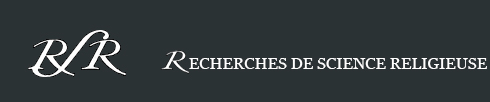





Vous souhaitez lire l'article dans son intégralité
Vous êtes abonné à RSR
En préparation
Si vous n'êtes pas abonné à RSR
> abonnez-vous en ligne et téléchargez gratuitement toutes les archives
> ou achetez le numéro concerné pour le recevoir à domicile
> ou téléchargez immédiatement l'article (3 TTC ou gratuit si l'article a plus de 5 ans de parution)