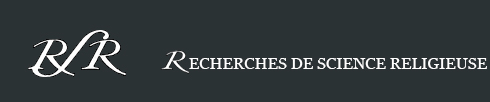Renouveau des théologies africaines
par Patrick C. Goujon
Pour la première fois les RSR consacrent un dossier entier aux théologies africaines et à leur renouveau. Bon nombre d’observateurs soulignent les bouleversements que vivent les sociétés et les Églises africaines. Chacun a entendu parler des mega-churches qui se multiplient en Afrique, de la créativité liturgique, de prélats réactionnaires, dont certains ont comme terrain l’Europe, semble-t-il, ou les violences que subissent les religieuses. Bribes d’information, risque de caricatures.
Ce que nous connaissons de la vie ecclésiale en Afrique atteint l’Europe de manière estompée, voire biaisée. La relation de nos pays à ceux de l’Afrique est complexe. Le passé colonial hante notre présent. Ce qui nous lie à l’Afrique est tissé de fils multiples, indémêlables. Le rôle missionnaire de la France et de la Belgique, pour ne citer que ces deux pays, est inséparable de l’histoire politique, économique et culturelle, sans y être réductible. Les relations ecclésiales n’échappent pas à cette complexité. Le journal Le Monde a consacré dans son édition du 17 août 2025 un long article sur le clergé africain vivant et travaillant en France. Le tableau nuancé fait ressortir les conditions humaines difficiles éprouvées par ce clergé. Certains des paroissiens ou de leurs pairs français oublient que ces prêtres sont parfois hommes d’expérience, certes bien éloignée de la nôtre. Cette vie ecclésiale d’expatriés n’échappe pas non plus aux tensions politiques de l’Église européenne marquée de préjugés racistes et de préférence nationale. On peut légitimement craindre que la présence en France d’un clergé à 30% d’origine étrangère, et en bonne part africain, finira bien par ne pas être tout à fait au goût des souverainistes catholiques français et à leur puissance médiatique, capable de forger facilement les opinions, y compris celles d’une partie de la hiérarchie catholique, bien prompte à oublier la Tradition catholique quand elle ne recoupe pas ses vues partisanes.
Du côté théologique, notre connaissance de l’Afrique risque bien aussi d’être parcellaire. Un grand nombre d’entre nous peut très bien en rester à quelques lectures marquantes de théologiens africains qui, dans la suite de Vatican II, furent les hérauts de l’inculturation. L’Église, dans ce tournant conciliaire, largement occidentalisée dans ses cadres et ses théologiens, reprenait aux Pères de l’Église un certain nombre de notions et apprenait d’eux cet art de la traduction théologique qui fit naître la Tradition. Il fallut passer de Jérusalem à Alexandrie, à Athènes puis à Rome. L’Église du vingtième siècle trouva dans la patristique de quoi bâtir des ponts entre l’Afrique et la culture théologique latine, elle-même profondément renouvelée par la patristique. Une théologie propre à l’Afrique surgissait dans les années 1970, en même temps qu’un avenir politique nouveau apparaissait, entre décolonisation et ère post-coloniale